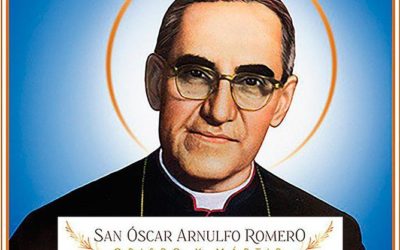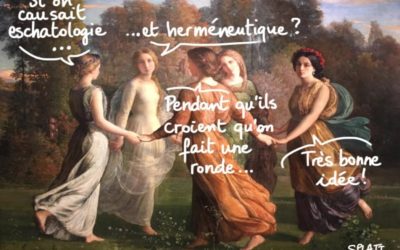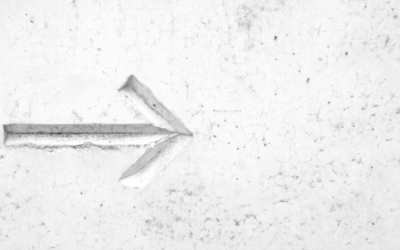Les conférences
Retrouvez ici toutes les conférences du Dorothy. Certaines conférences sont organisées par cycle. En cliquant sur un lien, vous trouverez des informations supplémentaires et vous pourrez écouter les podcasts enregistrés.
Christianisme et communisme
Blaise Pascal : misère et grandeur de l’homme
Femmes détenues : les oubliées
Oscar Romero : prophète d’une Eglise des pauvres.
Communauté et non-violence : à la découverte de Lanza del Vasto
L’acte de foi dans la philosophie de Kierkegaard
Comment mourir aujourd’hui ?
Catholique ou féministe : faut-il choisir ?
Prostitution : un regard abolitionniste
L’insurrection en Algérie a-t-elle un avenir politique ?
Quel regard féministe sur la GPA ?
L’Eglise est-elle une structure de péché ?
La prison fabrique-t-elle des criminels ?
L’école abêtit-elle ?
Qu’est-ce que le capitalisme ?
Cycle “Les valeurs du temps”
L’Etat de droit a t il disparu en Turquie ?
Quelle utilité pour la théologie de la libération aujourd’hui ?
Dieu sans maître : une présentation de l’anarchisme chrétien
Un projet soutenu par