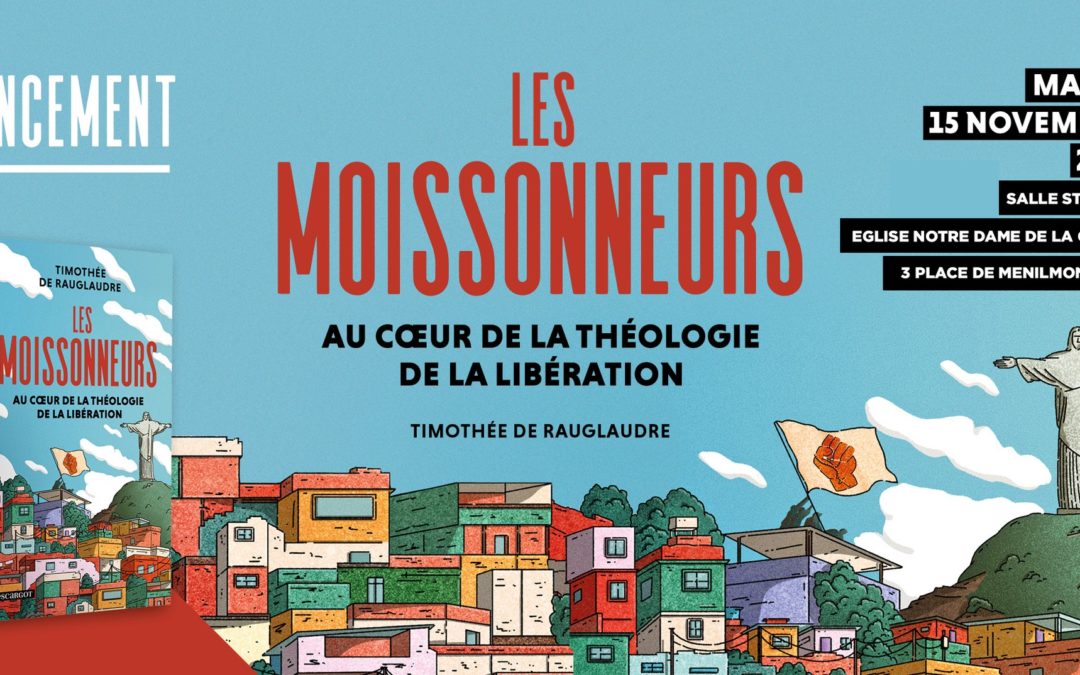A rebours du repli identitaire que nous connaissons aujourd’hui, de grandes figures chrétiennes se sont nourries spirituellement de leur rencontre avec l’islam. A travers un cycle de trois conférences, le Dorothy vous propose de suivre leurs cheminements : quel chemin spirituel ont-elles parcouru ? Comment ont-elles inscrite leur foi dans les configurations politiques de leur époque, marquée par la colonisation et les décolonisations ? Comment nous inspirer de leurs parcours pour nouer aujourd’hui le dialogue interreligieux ?
Jeudi 10 novembre. Conférence 1/3 : Les paradoxes de Charles de Foucauld.
À la fin du XIXe siècle, Charles de Foucauld, ancien militaire, s’est converti au christianisme – une conversion dans laquelle le contact avec l’islam semble avoir joué un certain rôle – puis a vécu au milieu des Touaregs musulmans. Homme de son temps et plongé dans un univers colonial, il ne doutait pas que les Touaregs se convertiraient un jour. Mais il avait vite compris que cette conversion serait, comme il disait, l’affaire « non d’années mais de siècles ». Lui-même ne se voulait, de toute façon, pas missionnaire (« je suis moine, non missionnaire, fait pour le silence et non pour la parole », a-t-il écrit), mais avait d’abord envisagé de composer un dictionnaire et une grammaire pour préparer la voie des missionnaires futurs. Il s’est donc mis à étudier la langue des Touaregs, mais, assez vite, ce travail est devenu un but en soi, poursuivi dans le seul souci de préserver un patrimoine culturel qu’il sentait menacé. En même temps qu’il étudiait leur langue, il s’efforçait de leur donner le témoignage d’une vie évangélique, conforme au modèle qu’il s’était donné, celui de la vie cachée de Jésus à Nazareth. Il deviendra l’ami des Touaregs du Hoggar, en Algérie, dont il partage le quotidien et traduit les écrits, et cultivera un lien très fort avec Moussa ag Amastan, leur chef. Charles de Foucauld a été canonisé par le pape François en mai 2022.
Avec Dominique Casajus, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des touaregs. Il est l’auteur de Charles de Foucauld. Moine et savant, (Paris, CNRS Éditions, 2009.)
Vous retrouverez ci-dessous l’intégralité de la conférence de D.CASAJUS mise à l’écrit. Bonne lecture !
***
FOUCAULD, L’ISLAM, LES TOUAREGS.
Foucauld s’est exprimé à plusieurs reprises sur l’islam, et notamment dans ses lettres à l’islamologue Henry de Castries. Le 15 juillet 1901, il lui écrivait :
Nous avons pour divin modèle Notre Seigneur Jésus, pauvre, chaste, ne résistant pas au mal et souffrant tout, paisible, pardonnant et bénissant. L’islam prend pour exemple Mahomet, s’enrichissant, ne dédaignant pas les plaisirs des sens, faisant la guerre : de ces deux sources si opposées, quels courants opposés doivent naître ![1]
Remarquons que ces lignes n’opposent pas tant deux religions que deux modèles de vie. Dans les années où il se cherchait, où il frappait à toutes les portes, l’islam en lui-même l’avait d’abord plutôt séduit et même, devait-il dire à Henry de Castries, « à l’excès »[2]. Plus encore, la grandeur et la simplicité de la religion du Prophète a peut-être contribué à le ramener à la foi :
[…] l’Islam a produit en moi un profond bouleversement, écrit-il toujours à Henry de Castries… la vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m’a fait entrevoir quelque chose de plus vrai que les occupations mondaines : “ad majora nati sumus” […]. »[3]
… au point que, même après son retour à la foi chrétienne en 1886, le nouveau converti entremêlait parfois des passages du Coran à ses prières[4].
Et l’on trouve déjà un nocturne et discret souvenir du Coran dans la relation du voyage d’exploration qu’il fit au Maroc à l’âge de vingt-cinq ans. Le 13 novembre 1883, aux abords de l’oasis de Tanzida, sa première nuit dans le désert lui avait inspiré ces lignes :
La lune, qui brille au milieu d’un ciel sans nuages, jette une clarté douce ; l’air est tiède, pas un souffle ne l’agite. En ce calme profond, au milieu de cette nature féerique, j’atteins mon premier gîte du Sahara. On comprend, dans le recueillement de nuits semblables, cette croyance des Arabes à une nuit mystérieuse, leïla el qedr, dans laquelle le ciel s’entr’ouvre, les anges descendent sur la terre, les eaux de la mer deviennent douces, et tout ce qu’il y a d’inanimé dans la nature s’incline pour adorer son Créateur.[5]
La Laylat al-Qadr (la « nuit du destin »), qui tombe le 21 du mois du ramadan, est selon la sourate 97 la nuit où Dieu fit descendre le Coran sur la terre. L’espace de ces quelques phrases, elle aura donné à la prose de Foucauld une douceur qu’on n’y retrouvera jamais plus. Moins de trois ans après les avoir écrites, le long dégoût qu’il portait en lui depuis l’adolescence le jetait aux pieds de l’abbé Huvelin, dans un confessionnal de l’église Saint- Augustin qu’une plaque désigne aujourd’hui à la piété des fidèles. On a peu de témoignages sur ces dernières années d’une vie profane que les deuils précoces, l’absence de vocation bien affirmée, un besoin toujours insatisfait de reconnaissance et d’amour avaient marquée d’une inguérissable mélancolie. Cette mélancolie qu’il avait cru si longtemps étourdir par les fêtes et les plaisirs, il s’engageait maintenant dans le cheminement intérieur qui la transmuerait en aspiration à la sainteté et au martyre. Et, marque peut-être des efforts qu’il dut faire sur lui-même pour surmonter sa première fascination, l’orientaliste qu’il aurait pu être s’est raidi dans une intolérance que je crois être avant tout une intolérance à la part de lui-même qu’il avait rejetée : la piété des musulmans l’avait ramené à la foi de ses pères, mais dans la voie qu’il faisait désormais sienne, cette religion « qui n’a pas assez de mépris pour les créatures »[6], ce Prophète sensuel et si plein des affaires du monde, se sont vus peu à peu rejetés dans les ténèbres extérieures, trop proches qu’ils apparaissaient à ses yeux d’une vie avec laquelle il avait rompu. Au fond, c’est de la débonnaireté même de l’islam que ne peut s’accommoder la foi intransigeante du Foucauld de la maturité – une intransigeance à la mesure des abîmes auxquels elle l’a arraché.
Tout ce que par la suite il allait dire de l’islam serait marqué par cette intransigeance. Ainsi, les propos qu’il tient à l’abbé Carron le 9 juin 1908 surprennent chez un homme que, de son propre aveu, la lecture des philosophes avait plongé dans une longue mécréance, et dont le retour au christianisme fut un mouvement du cœur et non de l’esprit :
Vis-à-vis des musulmans qui sont des demi-barbares, la voie n’est pas la même qu’avec des idolâtres, des fétichistes, des gens tout à fait sauvages, des barbares ayant une religion tout à fait inférieure, ni qu’avec les civilisés. Aux civilisés, on peut proposer directement la foi catholique, ils sont aptes à comprendre les motifs de sa crédibilité, et à en reconnaître la vérité ; aux tout à fait barbares de même, parce que leurs superstitions sont si inférieures qu’on leur fait assez facilement comprendre la supériorité de la religion d’un seul Dieu. Il semble qu’avec les musulmans, la voie soit de les civiliser d’abord, de les instruire d’abord, d’en faire des gens semblables à nous ; ceci fait, leur conversion sera chose presque faite elle aussi, car l’islamisme ne tient pas devant l’instruction ; l’histoire et la philosophie en font justice sans discussion : il tombe comme la nuit devant le jour.[7]
Dans la demi-barbarie où il situait les musulmans, il distinguait cependant des degrés. Au moment où il écrivait à l’abbé Carron, il y avait trois ans qu’il s’était installé au sein d’une population berbérophone. Or voici ce qu’il en dit le 4 juin 1908 à sa cousine Marie de Bondy :
Priez bien pour tous ces indigènes au milieu desquels je vis : tous ont droit qu’on travaille au salut de leurs âmes : les Touareg encore plus que les autres, si c’est possible. Les âmes ont toutes le même prix, celui du sang de Jésus, mais ne pouvant s’occuper de toutes, il semble qu’il faut s’attacher d’abord à celles qui laissent espérer les plus prompts et les meilleurs résultats : les Touareg sont de ceux-ci : c’est une race neuve, forte, intelligente, vive et non une race vieillie et en décadence ; très peu musulmans, c’est-à-dire pratiquant et connaissant peu leur religion tout en y ayant une foi vague, ils sont bien moins fermés pour nous que les Arabes.[8]
On peut, dans le même sens, citer aussi ce qu’il écrit au duc de Fitz-James le 11 décembre 1912 : « Les habitants de notre empire africain sont très divers : les uns, Berbères, peuvent devenir rapidement semblables à nous ; d’autres, Arabes, sont plus lents au progrès ; les nègres sont très différents les uns des autres. Mais tous sont capables de progrès »[9].
On reconnaît là certains thèmes de ce que Charles-Robert Ageron a appelé le mythe kabyle[10], fatras de stéréotypes qui avaient commencé à sévir dès les années 1820 avant de se transposer des Kabyles aux Touaregs puis, plus tard, aux montagnards berbérophones de l’Atlas marocain. Le plus tenace de ces stéréotypes voulait que l’islam eût été pour ces peuples une simple parenthèse qu’on refermerait aisément. Tâche à laquelle le cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger à partir de 1867, s’était employé avec un zèle que l’insuccès n’entama jamais, persuadé qu’il était de pouvoir ressusciter dans sa splendeur l’Église d’Afrique du temps de Saint Augustin. Foucauld était animé des mêmes espérances quand il s’installa parmi les Touaregs, et lui aussi croyait retrouver parmi eux des souvenirs de l’évêque d’Hippone :
Les populations de cette région, écrivait-il à sa cousine le 5 mars 1904, comme celles du Maroc, parlent moins l’arabe que le berbère, vieille langue du Nord de l’Afrique et de la Palestine, celle que parlaient les Carthaginois, celle de sainte Monique, dont le nom, berbère et non grec, signifie : “reine”[…].[11]
Je suppose que ces très fantaisistes variations philologiques s’inspirent du mot touareg amenokal (tamenokalt au féminin), dont les trois premières consonnes (MNK) sont effectivement les trois consonnes de Monika. Disons tout de même à sa décharge que Foucauld venait à peine d’entamer les travaux qui feraient de lui l’un des maîtres de la linguistique touarègue, et qu’on ne trouve pas de telles extravagances dans sa correspondance ultérieure. Il finira d’ailleurs par perdre quelques-unes de ses illusions et par admettre que la conversion des Touaregs serait « l’œuvre non d’années mais de siècles »[12].
C’est justement de ces travaux linguistiques que je vais maintenant parler, car ils relève sinon du rapport de Foucauld à l’islam du moins de son rapport avec ces musulmans qu’étaient les Touaregs.
Dans les faits, il s’est interdit tout prosélytisme durant son séjour à Tamanrasset, proclamant même dès le 2 juillet 1907 : « Je suis moine, non missionnaire, fait pour le silence, non pour la parole »[13]. Or ce moine fermé à la religion de ses hôtes aura été un savant attentif à leur culture. Lui qui tenait les Touaregs pour des demi-barbares, aura consacré à l’étude de leur langue et de leur poésie plus d’efforts que personne avant lui ni probablement après lui. Au départ, son objectif était simplement de composer un lexique et une grammaire élémentaires à l’usage des officiers sahariens et des missionnaires à venir.
Charles de Foucauld était loin d’imaginer, lorsque, le 13 janvier 1904, il quittait son ermitage de Béni-Abbès à la demande du colonel Laperrine, commandant supérieur du territoire des Oasis, pour se mettre en route vers le pays touareg, que, sitôt sa destination atteinte, l’essentiel de son temps de veille allait être consacré à une œuvre linguistique dont l’élaboration l’occuperait jusqu’à l’heure de sa mort. Cette œuvre ne se dessina que peu à peu, mais une lettre du 10 février 1914 à sa sœur Marie de Blic montre qu’il en possédait à cette date les grandes lignes et qu’il espérait l’achever avant la fin de 1918 « si, ajoutait-il, Dieu me prête vie, santé…[14] ».
C’était trop présumé de la bienveillance divine. Il avait cependant le sentiment, au soir du peu de vie qui lui avait été assigné, que l’essentiel était fait. Ainsi, dans une lettre du 5 décembre 1916, le capitaine commandant le peloton méhariste du Hoggar parlait à René Basset, le doyen de la faculté d’Alger, du « gros travail que le Révérend Père était sur le point d’achever » et ajoutait : « J’ai pu, au cours de mes nombreuses visites chez le Révérend Père consulter ses copies, et de son aveu lui-même, et, vous savez si ce vénérable ermite était modeste, il considérait son livre comme très complet[15] » (Chatelard 2000 : 178). Ce « livre » est très certainement l’ensemble formé par les manuscrits du Dictionnaire touareg-français et des Poésies touarègues, que René Basset et son fils André ont publiés poshumément. Le diaire de l’auteur nous apprend qu’il avait achevé la mise au net du premier le 24 juin 1915 et mis la dernière main au second le 28 novembre 1916[16], soit trois jours avant sa mort.
Son objectif au départ était d’aider les missionnaires futurs, et il entrepris dès avant d’atteindre le pays touareg, de faire traduire les évangiles en touareg. Mais l’œuvre finale aura peu à voir avec cet objectif initial, qu’il a vite abandonné.
Il aura d’abord fallu pour cela que son zèle apostolique, alors l’unique aliment de son ardeur à la tâche, se double d’un intérêt authentique pour son objet d’étude. J’ai évoqué ailleurs l’évolution douloureuse qui va le conduire là, et ce n’est pas ici le lieu de la retracer en détail. Disons simplement que sa courte collaboration avec son vieil ami Adolphe de Calassanti-Motylinski[17] semble avoir joué dans l’affaire un rôle déterminant. Professeur d’arabe à Constantine et bon connaisseur des parlers berbères, Motylinski avait consacré en 1904 un ouvrage au dialecte berbère de Ghadamès. Il arrive à Tamanrasset le 3 juin 1906, venu là à la demande d’un Foucauld qui, désireux d’améliorer les traductions du Nouveau Testament qu’il a recueillies, souhaite bénéficier au moins pour quelque temps de l’assistance et des conseils d’un berbérisant plus confirmé que lui. Or, ce que propose le nouveau venu est assez différent de ce que son hôte avait en tête : il entend, comme il l’a fait lui-même à Ghadamès et comme le font déjà depuis des années tous les spécialistes des divers parlers maghrébins – arabes ou berbères – recueillir des textes en prose ou en vers, des conversations ou des données sociologiques. Autrement dit, son intention est de faire de la version plutôt que du thème. Les deux hommes travaillent ensemble à Tamanrasset et dans ses environs jusqu’au début du mois d’août, puis Motylinski part sillonner l’intérieur du Hoggar – tournée dans laquelle Foucauld ne peut l’accompagner car une morsure de vipère l’a contraint à l’immobilité. Le 12 septembre, tous deux se mettent en route vers le nord, l’un pour regagner Constantine, l’autre pour revoir son ancien ermitage de Béni-Abbès et passer quelque temps à Alger.
La traduction des saintes écritures, dont Foucauld avait pensé que son ami pourrait l’aider à la parfaire, a donc cessé d’être son objectif primordial. Et un événement imprévu va même le conduire à mettre ce travail totalement de côté : Motylinski meurt du typhus le 2 mars 1907. La nouvelle de sa mort parvient à Foucauld le 14 mars[18], et, dès le lendemain – ce qui montre combien ces travaux de linguistique ont pris de l’importance pour lui – il écrit à René Basset, doyen de la faculté des lettres d’Alger, pour lui proposer de réviser les travaux du défunt. Une première livraison paraît à Alger en 1908, présentée comme écrite par Motylinski et publiée par les soins de René Basset, car Foucauld a refusé que son nom soit mentionné[19]. Conscient dès avant sa publication de l’insuffisance de cette première ébauche, il décide de tout reprendre à la base, mais présentera toujours ses travaux comme la révision de ceux de Motylinski. C’est donc par fidélité à la mémoire d’un ami que Charles de Foucauld a consacré tant d’années à une œuvre sans commune mesure avec ce qu’aurait été la simple révision des travaux du défunt. Il lui arrivera de gémir de l’ampleur de la tâche qu’il s’est ainsi fait un devoir de mener à bien. Non qu’il ait jamais été homme à reculer devant le labeur, mais ces longues heures (jusqu’à plus de onze par jour) consacrées à un travail profane étaient pour lui un temps fâcheusement ôté à la prière proprement dite, et même à ce « saint travail des mains » auquel la règle cistercienne accorde la même valeur qu’à la prière. Pourtant, dans le tourment, le malaise et le scrupule, le savant et le moine ont fini par marcher d’un même pas[20].
1.3. Un sujet « qui intéresse d’abord la science et ensuite le peuple touareg ».
Du reste, une lettre du 29 mai 1908 à René Basset révèle que ses scrupules ne l’ont pas empêché de prendre très tôt conscience de l’éminente dignité de son objet d’étude. Il y énumère en détail les recherches scientifiques (linguistiques, sociologiques, archéologiques…) qu’il souhaiterait voir entreprendre en pays touareg. Ce n’est pas, au moment où il écrit, un programme qu’il se fixe à lui-même : seul, estime-t-il, un homme jeune, ayant trente ans devant lui, pourrait le réaliser. Mais le fait même qu’il prenne tant de soin à détailler un programme qu’il ne se croit pas en mesure de mener à bien lui-même est le signe que ses préoccupations scientifiques ne sont plus nécessairement liées un quelconque projet missionnaire. Il n’en est plus, en effet, à s’interroger sur ce qu’il doit faire pour être à même de faire traduire les saintes Écritures, ou pour fournir des manuels à l’usage des missionnaires futurs, mais entend exposer les linéaments d’un projet qui, dit-il, « intéresse d’abord la science et ensuite le peuple touareg ». Lisons :
Je vais maintenant vous entretenir d’un autre sujet que j’ai très à cœur, et vous aussi certainement, car il intéresse d’abord la science et ensuite le peuple touareg.
Même après la publication de tous les résultats du voyage dans l’Ahaggar[21] de notre cher ami Motylinski, une infime partie seulement du travail à faire aura été faite.
Ce qui reste à faire dans l’Ahaggar c’est :
1° achever de collectionner les poésies des Kel-Ahaggar, non pas en prenant, comme on a été obligé de le faire jusqu’ici, tout ce qui était présenté, mais en collectionnant auprès de chacun des poètes en renom vivants, très bien connus aujourd’hui, leur répertoire complet ; en s’enquérant, dans leurs tribus respectives, des poésies des poètes renommés morts ; en recueillant les poésies anciennes dont les auteurs ne sont pas connus et qui ont du mérite… J’estime que le répertoire complet de ce qui a du mérite dans les poésies de l’Ahaggar, de l’Ajjer et des Taïtoq est d’au moins 30 000 vers et qu’il faudrait 4 ans de travail continu pour les recueillir et les traduire. […] Quatre ans de travail, avec tous les deux ans 8 mois de congé (4 passés en France, pour l’aller et le retour), cela fait six ans à consacrer au seul collectionnement de la littérature touareg-nord. Il est très nécessaire que ce travail soit fait bientôt, car comme les poésies ne sont jamais écrites, il n’y a à bien les savoir que peu de gens, et pour beaucoup, que leur auteur : la mort d’un bon poète c’est la perte irrémédiable de la plupart de ses poésies.[22]
Les vers touaregs peuvent donc avoir « du mérite », et ils sont même des dizaines de milliers dans ce cas. Bien que ne connaissant pas le niveau de valeur littéraire à partir duquel un vers commence pour lui à avoir du mérite, je pense que c’est là une appréciation plutôt positive sur la littérature de ses hôtes. Quant à sa crainte de voir ces vers sombrer dans l’oubli avant qu’on ait pu les recueillir, elle témoigne d’un souci analogue à celui que les ethnologues ont fait leur après lui, à commencer par celui qui allait écrire, à la suite d’enquêtes de terrain à peu près contemporaines des dernières années de Foucauld en pays touareg : « L’ethnologie, se trouve dans une situation à la fois ridicule et déplorable, pour ne pas dire tragique, car à l’heure où elle commence à s’organiser, à forger ses propres outils et à être en état d’accomplir la tâche qui est sienne, voilà que le matériau sur lequel porte son étude disparaît avec une rapidité désespérante[23] ». Sans doute Malinowski – car c’est lui – songe-t-il à l’ensemble des institutions des sociétés dont il déplore la rapide disparition, et pas seulement à leur littérature. Mais Foucauld y songe lui aussi. Poursuivons en effet notre lecture :
Une seconde raison pour se presser, c’est que le pays subit en ce moment une transformation. Autrefois il vivait de pillage et dans une grande abondance ; la viande et le lait étaient à profusion grâce aux razzias chez les voisins ; vêtement, étoffes, objets de luxe affluaient, grâce au pillage des caravanes ; entre deux razzias, on se divertissait sous les tentes, on y chantait, on y faisait des vers et de la musique, en chantant les exploits récents et on récompensait, en leur accordant la préférence, les plus heureux pillards… C’était l’ahâl et l’egen se succédant l’un à l’autre, dans l’abondance et la richesse… Maintenant plus de razzias, plus de pillage, paix obligatoire ; par suite, pauvreté : il n’y a plus de vainqueur à chanter : on n’est plus très gai, on a souvent faim ; on n’a plus de beaux habits pour aller à l’ahâl ; la pauvreté et la paix forcée font ainsi cesser presque complètement l’ahâl ; le peu qui en reste est bien différent de l’ancien et le sera de plus en plus… Il faut donc se hâter de prendre de répertoire poétique actuellement existant, car ou bien il ne sera pas remplacé, ou il le sera par quelque chose de très différents.[24]
Les mots ahâl et egen apparaissent plus d’une fois dans les poésies datant de l’époque, alors révolue, où la vie des touaregs – du moins ceux de la noblesse – se consumait dans les aventures guerrières. L’egen est ce que nous appelons une razzia, c’est-à-dire une expédition ayant en général pour but le pillage. Foucauld en exagère un peu le rôle économique. Certaines razzias duraient des mois, leur butin était parfois bien maigre, et on y prenait part autant pour prouver sa valeur que par appât du gain. De plus, il semble ne pas soupçonner que si « l’on n’est plus très gai », c’est aussi parce qu’on vit sous la botte. Quant à l’ahâl, c’était une réunion où jeunes femmes et jeunes hommes s’assemblaient à la nuit tombante, pour se divertir et deviser ; il arrivait qu’une des dames y joue du violon en l’honneur d’un des hommes présents lorsqu’il s’était illustré pour sa bravoure. Tout ce passage est assez surprenant. Foucauld, qui s’est maintes fois félicité dans sa correspondance de ce que l’occupation française ait imposé la paix au pays (une paix partielle, du reste, car il fallait tout de même se défendre contre les attaques venues des régions encore insoumises), mesure ici, avec ce qui ressemble presque à de l’inquiétude, tout ce que ces changements forcés vont bientôt faire disparaître. Mais poursuivons :
2° le second travail à faire après le collectionnement des poésies, c’est l’achèvement du lexique touareg-fr. (dialecte de l’Ahaggar). –- Le vocabulaire général des textes de M. de Molylinski contient beaucoup de mots nouveaux et tous ceux anciennement connus ; malgré cela beaucoup manquent encore : la traduction du reste du répertoire poétique Ahaggar-Ajjer-Taïtoq donnera, au fur et à mesure, un certain nombre de mots nouveaux : les conversations pendant ces 6 ans (coupés de trois congés) en donneront aussi ; il restera à collectionner des noms de plantes ; des noms d’oiseaux, d’insectes, d’animaux, des noms de maladies des personnes et des animaux, des noms spéciaux d’instruments, d’ustensiles, de vêtements, de particularités physiques des personnes et des animaux. – Il restera aussi à compléter le vocabulaire des noms propres de personnes, tribus et lieux. – cela demandera à un homme, rompu à ce genre de travaux par les six années précédentes d’études, deux ans […]
3° grammaire et sociologie de l’ahaggar seront faciles après ces 8 années et pourront se faire en 2 ans. – Cela fait dix ansen tout.
Et alors il n’y aura que l’Ahaggar, l’Ajjer et [le] pays Taïtoq d’étudiés, et seulement aux points de vue littéraire et linguistique.
Ceci fait, un autre travail s’imposerait. Tout le pays Touareg, non seulement l’Ahaggar, mais l’Ajjer, l’Ahenet, l’Adrar, l’Aïr, sont couverts de sépultures et parfois de monuments antéislamiques : il faudrait en fouiller un très grand nombre et recueillir les inscriptions et dessins rupestres nombreux : il est certain que ces fouilles donneraient des résultats très intéressants et jetterait du jour sur l’histoire antéislamique du pays ; en certains lieux, tels que les environs de Tit (Ahaggar) et certaines parties de l’Adrar, on est confondu de la grandeur et du nombre de ces sépultures et monuments. Je crois que cela demanderait bien quatre ans […] pour l’Ahaggar, l’Ajjer, l’Ahenet, la partie de l’Adrar dépendant de l’Ahaggar et les déserts environnant l’Ahaggar. […]
Et après il faudrait en faire autant pour l’Adrar et l’Aïr cela irait bien plus vite pour une personne exercée par les 15 ans de travail précédents. Il est probable que 7 ans suffiraient pour chacun des 2 pays…
C’est trente ans en tout, toute la vie d’un homme.[25]
Ce n’est plus le missionnaire ni même le religieux qui parle, c’est l’homme conscient de l’étendue d’un patrimoine culturel – notamment linguistique – qu’il tremble de voir disparaître avant qu’on ait pu le recueillir. Non que sa foi se soit attiédie, mais elle n’est pour rien dans l’anxiété que cette lettre exprime. D’ailleurs, même s’il dit attendre qu’un autre que lui exécute ce gigantesque programme, il a entamé depuis un an un travail qui en est déjà l’amorce. Motylinski l’ayant « chargé de lui recueillir des poésies touarègues non encore connues[26] », c’est une collection de 572 poèmes, soit près de 6000 vers, qu’il a recueilli entre le 18 mars et le 6 juillet 1907.
Lui qui était venu, sûr de lui, pour apporter la bonne parole à ses hôtes aura au bout du compte fait un immense effort pour recevoir leur parole à eux. Dans le même temps, se développait une grande amitié pour certains d’entre eux.
L’un des témoignages de cette amité est constitué par les lettres en touareg qu’il a reçues de ses amies[27]. Il serait certes imprudent de surinterpréter de simples formules épistolaires, dont on peut même se demander si certaines, comme le « je t’embrasse » du jeune Ouksem qu’il a emmené en France en 1913, ne sont pas davantage destinées à complaire au vieil ermite qu’à exprimer des sentiments réellement éprouvés ; mais il se trouve que Foucauld parle souvent à ses correspondants français de l’affection que lui portent ses voisins Dag-Ghali, qui sont précisément les signataires de la plupart de ces petits billets. Le 11 juillet 1907, au retour de la deuxième tournée Dinaux, il dit à sa cousine sa surprise d’avoir été accueilli par ses voisins « beaucoup plus affectueusement [qu’il] n’osai[t] l’espérer[28] ». En mai 1911, après son deuxième voyage en France, il est à nouveau « reçu avec une affection qui [l’]a touché par les Touaregs et [il a] à tout moment leurs visite[29] », et cela lui « fera de la peine de quitter ces braves gens dans un mois [pour aller à l’Asekrem][30] » Lui aussi dit son affection, tout au moins à l’endroit d’Ouksem ag Chikat. Il l’« aime beaucoup[31] », le « traite comme [s]on fils[32] » et le tient pour « celui des Touaregs [qu’il] estime le plus et aime le plus[33] ». Citons également ce qu’il dit à un ami officier : « J’ai au moins quatre “amis”, sur qui je peux compter entièrement. Comment se sont-ils attachés à moi ? Comme nous nous lions entre nous. Je ne leur ai fait aucun cadeau, mais ils ont compris qu’ils avaient en moi un ami, que je leur étais dévoué, qu’ils pourraient avoir confiance en moi et ils m’ont rendu la pareille de ce que j’étais pour eux. [Quatre noms suivent, dont celui d’Ouksem et de son père Chikat]. Il y en a d’autres que j’aime, que j’estime, sur qui je puis compter pour beaucoup de choses. Mais ces quatre-là, je puis leur demander n’importe quel conseil, renseignement, service, je suis sûr qu’ils me le rendront de leur mieux[34]. »
Plus d’une fois il parle des « consolations » que lui apportent ses voisins. « Oui, c’est vrai, écrit-il à sa cousine le 16 mars 1912, j’ai des consolations avec les Touareg ; de plus en plus, je trouve parmi eux de braves gens, avec lesquels de véritables et sérieuses relations d’amitié s’établissent[35]. » Le 1er mars 1912, il lui a déjà dit combien ses « voisins touaregs sont consolants et doux[36] » ; il lui redit le 15 août 1912 qu’ils sont « consolants, affectueux[37] ». Le 4 septembre 1912, c’est à Henry de Castries qu’il écrit : « Les Kel Ahaggar de mon voisinage me donnent les plus grandes douceurs et consolations ; j’ai parmi eux d’excellents amis[38]. » Il lui écrit le 8 janvier de l’année suivante : « J’ai passé tout 1912 dans ce hameau de Tamanrasset. Les Touaregs m’y sont une très consolante société ; je ne puis dire combien ils sont bien pour moi, combien je trouve parmi eux d’âmes droites ; un ou deux d’entre eux sont de vrais amis, chose si rare et si précieuse partout[39]. » À Laperrine lui-même, avec qui il est d’habitude plus réservé, il écrit le 7 janvier 1912 : « Tous les Touaregs du voisinage, Dag Rali[40] surtout, sont la perfection pour moi, tout de ce côté est consolation et douceur[41]. » Comment mieux dire que ses voisins Dag-Ghali ont contribué à rasséréner l’ermite dont l’intransigeance effrayait en 1905 jusqu’à son directeur spirituel.
Les biographes ont largement sous-estimé cet aspect de la vie saharienne de Foucauld. C’est flagrant chez Bazin. Il évoque certes en termes équitables la haute figure de Moussa agg Amastan, mais quand il en vient aux proches de Foucauld, aux bons plébéiens qui ont partagé sa vie quotidienne, ils n’ont pas droit à la même considération : « Le Père de Foucauld, écrit-il, avait en effet une grande affection pour Chikkat [sic], et son fils Ouksem dont il fit un de ses légataires ; j’affirme moins que d’aussi nobles sentiments lui étaient rendus en retour ; Ouksem participa en effet très activement au mouvement de rébellion qui éclata en février chez les Hoggar, deux mois après l’assassinat du Père de Foucauld[42]. » Donnons-lui acte de la nuance, malgré la bizarrerie syntaxique : quand on affirme, même « moins », c’est déjà le signe qu’on hésite à nier. Le témoignage d’Antoine Chatelard, qui a bien connu Ouksem et plusieurs amis Dag-Ghali de Foucauld avant leur mort, nous permettra d’être plus affirmatif. Tout d’abord, les assaillants du 1er décembre 1916 envisagèrent de livrer le corps de Foucauld aux chiens de Chikat[43]. Il ne leur aurait donc pas déplu, ayant assassiné le premier, d’humilier le second après l’avoir endeuillé : c’est dire qu’ils savaient combien les deux hommes s’aimaient. De plus, les Dag-Ghali n’entrèrent en dissidence qu’après l’assassinat de l’ermite et les expéditions punitives qui suivirent, précision importante quand on sait en quoi consistaient ces expéditions : les militaires « chassaient les troupeaux et les gens, razziaient et faisaient des prisonniers[44] ». Est-ce trahir Foucauld que d’avoir réagi les armes à la main à ce qu’il faut bien appeler des exactions ? Encore les Dag-Ghali n’oublièrent-ils pas que certains Français avaient été leurs amis et se montrèrent-ils cléments à leur égard lorsqu’ils les firent prisonniers. Des liens s’étaient tissés, avec Foucauld, avec quelques autres Français, que les Dag-Ghali ne renièrent pas, mais qui ne changeaient rien à un fait brutal : l’armée française était une armée d’occupation.
Dans le meilleur des cas, les biographes n’ont guère parlé des voisins touaregs de Foucauld que pour célébrer ce qu’ils lui doivent. Il est un fait que, s’il n’a pas – loin s’en faut – soupçonné l’injustice du fait colonial, il a souvent œuvré pour leur en épargner les excès, au point que Louis Kergoat a pu écrire, avec peut-être une pointe d’humour, qu’il jouait auprès d’eux le rôle d’un délégué syndical[45]. Mais ses voisins eux aussi, on le voit, lui ont apporté quelque chose, à commencer par une amitié qui a peut-être sa part dans l’apaisement de cette âme longtemps ennemie d’elle-même. Or, de cela, les biographes n’ont guère tenu compte. Ainsi, le titre sous lequel le père Gorrée a publié les lettres de Foucauld à ses amis officiers (« Les amitiés sahariennes du Père de Foucauld »[46]) suppose implicitement qu’un indigène ne saurait compter comme ami. Écrivant près de cinquante ans plus tard, Jean-François Six a encore du mal à faire leur place aux Touaregs lorsqu’il écrit : « L’on sait à quel point Foucauld est sorti d’une certaine fuite du monde et d’un goût d’érémitisme qui l’ont marqué dans les quinze ans qui ont suivi sa conversion, pour se jeter à corps perdu dans l’amour simple et quotidien de chaque homme, chaque frère rencontré, au désert, jusqu’à sa mort[47]. » Pour ce qui est de Foucauld lui-même, je crois effectivement être parvenu ici à une conclusion voisine – à la grandiloquence près. Mais pourquoi faudrait-il que les hommes rencontrés au désert n’aient eu qu’un rôle passif dans cette évolution ?
Avec les Touaregs de la noblesse, les sentiments de Foucauld sont beaucoup plus mêlés. C’est que rien n’est jamais totalement gratuit chez lui, et il va me falloir troubler l’atmosphère idyllique où les pages précédentes ont peut-être plongé le lecteur : le temps n’était pas à l’idylle dans ce Sahara fraîchement soumis, et Foucauld était un homme de son temps. De même que l’affection paternelle qu’il voue à Ouksem ag Chikat se double du désir de l’arracher à la foi de ses pères, de même il songe toujours aux rôles que l’administration coloniale peut faire jouer aux uns et aux autres. Les Dag-Ghali, et les plébéiens en général, ont sur ce point toute sa confiance. Dans les lettres où il dit les consolations qu’il reçoit d’eux, il ajoute : « ces imrad[48] touaregs sont les plus braves gens du monde ; on dirait les meilleurs de nos campagnards de France […] ils vivent selon les lumières naturelles et certains sont des âmes très droites[49] » ; eux « qui sont le nombre, la force, la portion saine du pays, sont tout à fait de bons ruraux de France[50] ». Il n’en est pas de même pour les nobles. À l’intention de ses amis militaires, il les oppose aux plébéiens dans des peintures de mœurs d’où la demi-teinte est exclue. En voici deux exemples, pris parmi bien d’autres. Au Hoggar, écrit-il le 7 décembre 1911, « les Imrad sont très supérieurs moralement aux Nobles, bien que ces derniers aient certaines qualités de bonne éducation et d’agrément de rapport, mais ces qualités sont des riens, de pure surface, tandis que les Imrad ont de bonnes qualités de fond, du moins ceux que je connais : les Dag Rali sont très laborieux, tout le monde travaille chez eux, même les plus riches ; jusqu’à présent les Nobles sont restés irrémédiablement paresseux »[51]. Et le 21 juillet 1914 : «… l’Ahaggar, si longtemps repaire de bandits, est devenu le pays de la grande paix et du grand calme. Les Nobles, qui étaient les bandits, sont appauvris, annihilés, et leur nombre, déjà minime, va décroissant ; […] quant aux Imrad, c’est-à-dire aux plébéiens, ce sont en général de braves gens, paisibles et laborieux : ils ont fort accru leurs cultures, les augmentent de jour en jour et tendent à se sédentariser : c’est le commencement de la civilisation[52]. »
La situation coloniale n’explique cependant pas tout, car on peut se demander s’il n’y a pas une autre raison, plus profonde et plus douloureuse, à la sévérité de l’ermite envers la noblesse du Hoggar. Les tableaux naïfs qu’il brosse pour édifier ses amis militaires ont, en effet, des couleurs bien trop contrastées pour ne pas susciter quelques questions. Ne serait-ce pas aussi ses souvenirs de jeunesse qu’il croit voir ressurgir au spectacle de ces gentilshommes raffinés mais vains ? et serait-il si touché par ces plébéiens travaillant de leurs mains et vertueux comme de bons paysans français s’ils ne représentaient pas, même imparfaite, une réalisation de son idéal de vie laborieuse ?
Ainsi aura été Foucauld avec les Touaregs. Il était venu pour œuvrer à leur conversion future, pour leur apporter sa parole. Il aura eu l’humitié d’écouter leur parole et de la transcrire, un travail qui l’aura occupé jusqu’à son dernier jour.
[1] Foucauld, Charles de, Lettres à Henry de Castries, Paris, Grasset, 1938, p. 90-91.
[2] Lettre à Henry de Castries du 15 juillet 1901, ibid., p. 86.
[3] Lettre à Henry de Castries du 8 juillet 1901, ibid., p. 86.
[4] Lettre à Henry de Castries du 14 août, ibid., p. 97.
[5] Foucauld, Charles de, Reconnaissance au Maroc, Clichy, Éditions du Jasmin, 1999, p. 167-168.
[6] Lettre à Henry de Castries du 15 juillet 1901, Foucauld, op. cit. (1938) p. 91.
[7] Foucauld, Charles de, Écrits spirituels, Paris, J. de Gigord, 1925, p. 256-257, soulignements de Foucauld.
[8] Foucauld, Charles de, 1966. Lettres à Mme de Bondy. De la Trappe à Tamanrasset, Paris, Desclée de Brouwer, 1966, p. 170.
[9] Bazin, René, Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite du Sahara, Paris, Plon, 1921, p. 408.
[10] Ageron, Charles-Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF, 1968, p. 269 sqq.
[11] Foucauld, op. cit., (1966), p. 126.
[12] Lettre à Suzanne Perret du 25 avril 1907 in Six, Jean-François, L’aventure de l’amour de Dieu, 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis Massignon, Paris, Seuil, 1993, p. 275.
[13] Lettre à Monseigneur Guérin in Six, op. cit., (1993), p. 280.
[14] In Gorrée, Georges, Sur les traces de Charles de Foucauld, Paris, Arthaud, 1947 : 280.
[15] In Chatelard, Antoine, La mort de Charles de Foucauld, Paris, Karthala, 2000 : 178.
[16] Foucauld, Charles de, Carnets de Tamanrasset, Paris, Nouvelle Cité, 1986 : 367 et 398.
[17] Habituellement appelé « Motylinski » dans la correspondance de Foucauld et dans les publications des spécialistes. C’est l’appellation que j’emploierai.
[18] Gorrée, op. cit., 1936 : 208.
[19] Motylinski 1908. Bien que le volume soit présenté comme un « tome premier », aucun autre tome n’a été publié. Au fond, le « tome second », c’est l’œuvre de Charles de Foucauld.
[20] Sur ce point, je me permets de renvoyer à Casajus, Dominique, Charles de Foucauld moine et savant, Paris, CNRS Éditions, 2009. Il faut bien sûr consulter aussi Antoine Chatelard, Antoine, « Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré lui », Études et Documents berbères, n° 13, 1995, p. 145-177.
[21] Ahaggar est le nom touareg de la région que les Arabes, et les Français à leur suite, appellent le Hoggar.
[22] Foucauld, Charles de, « Lettres du père Charles de Foucauld à Monsieur René Basset, doyen à la faculté des Lettres d’Alger », Études et Documents berbères, n° 19-20, 2001-2002 : 175-290, aux pages 188-189.
[23] Malinowski Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1963 [1922] : 48.
[24] Foucauld op. cit., 2001-2002 : 189. Soulignements de Foucauld.
[25] Ibid. : 189-190.
[26] Lettre à René Basset du 15 mars 1907. Voir ibid. : 175.
[27] Voir Galand, Lionel, Lettres au marabout. Messages touaregs au père de Foucauld, Paris, Belin, 1999.
[28] Foucauld, Charles de, Lettres à Mme de Bondy. De la Trappe à Tamanrasset, Paris, Desclée de Brouwer, 1966 : 160.
[29] Lettre à Henry de Castries du 16 mai 1911 (Foucauld, op. cit., 1938 : 191).
[30] Lettre à Marie de Bondy du 6 mai 1911 (Foucauld, op. cit., 1966 : 197). Voir aussi les lettres du 24 juin, 31 juillet, 15 août et 28 octobre 1912, du 18 décembre 1913 et du 31 juillet 1916 (ibid : 209, 210, 213, 245).
[31] Lettre à R. Basset du 23 juin 1912.
[32] Lettre à Marie de Bondy du 4 septembre 1912 (Ibid. : 211).
[33] Lettre à Henry de Castries du 18 janvier 1913 (Foucauld, op. cit. 1938 : 196).
[34] Cité in Chatelard, Antoine, « Une famille proche de Charles de Foucauld », Bulletin trimestriel des amitiés Charles de Foucauld 109, 1993 : 16-21. : 20-21.
[35] Foucauld, op. cit., 1966 : 206.
[36] Ibid. : 206.
[37] Ibid. : 210.
[38] Ibid. : 195.
[39] Foucauld, op. cit., 1938 : 196.
[40] Dag-Rali est une autre transcription de Dag-Ghali. Le R était probablement assorti dans l’autographe de Foucauld d’un point souscrit que les éditeurs n’ont pas conservé.
[41] Lettre conservée dans le fond Auguste Terrier de la bibliothèque de l’Institut.
[42] Bazin, René, Charles de Foucauld. Explorateur du Maroc, ermite au Sahara, Paris, Plon 1921 : 456, note 1.
[43] Chatelard, Antoine, « Ouksem, l’un des amis du Père de Foucauld, vient de mourir », Le Saharien, 56 : 18-21.1 : 18-19.
[44] Chatelard ibid.
[45] Kergoat, Louis, Charles de Foucauld et l’islam. Politique et mystique, thèse d’Etat, Université de Paris-Sorbonne, 1988, i : 181.
[46] Gorrée, Louis, Les amitiés sahariennes du Père de Foucauld, Paris, Arthaud, 2 tomes, 1946.
[47] Six, op. cit. 1993 : 328.
[48] « Imrad » est une transcription du terme touareg que je traduis par « plébéiens ». Là encore, Foucauld adjoignait probablement un point souscrit au r.
[49] Lettre à Henry de Castries du 10 décembre 1911 (Foucauld, op. cit., 1938 : 193).
[50] Lettre à Marie de Bondy du 15 août 1915 (Foucauld, op. cit., 1966 : 210).
[51] Lettre au capitaine Charlet (in Gorrée, op. cit., 1946, ii : 320).
[52] Lettre au capitaine Voinot (in Gorrée, ibid., ii : 136).