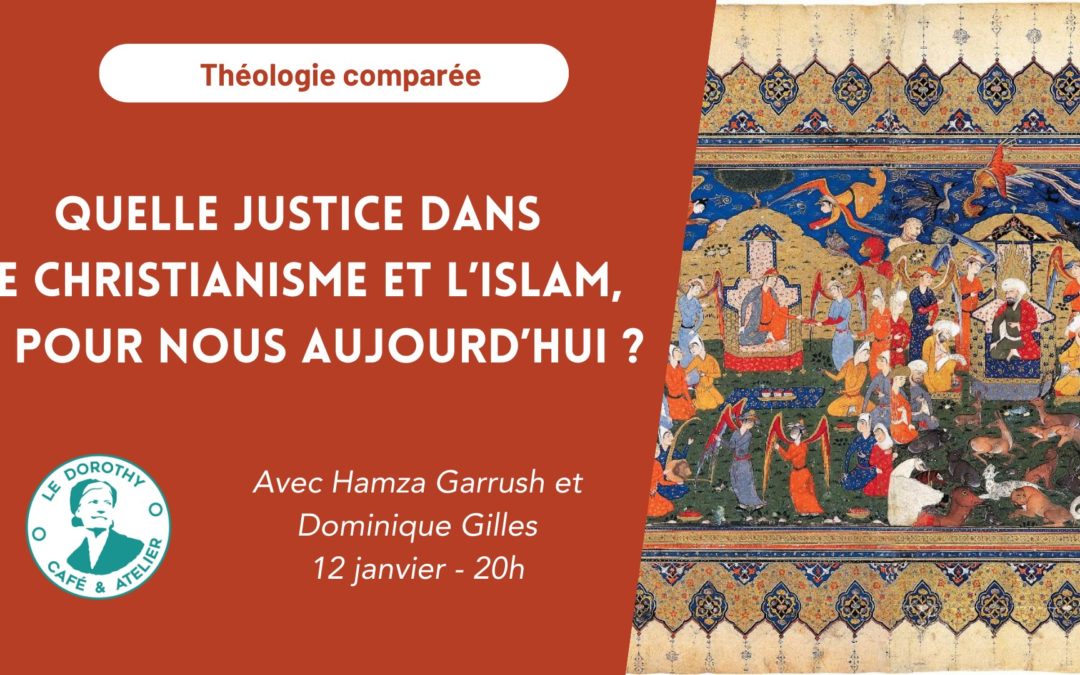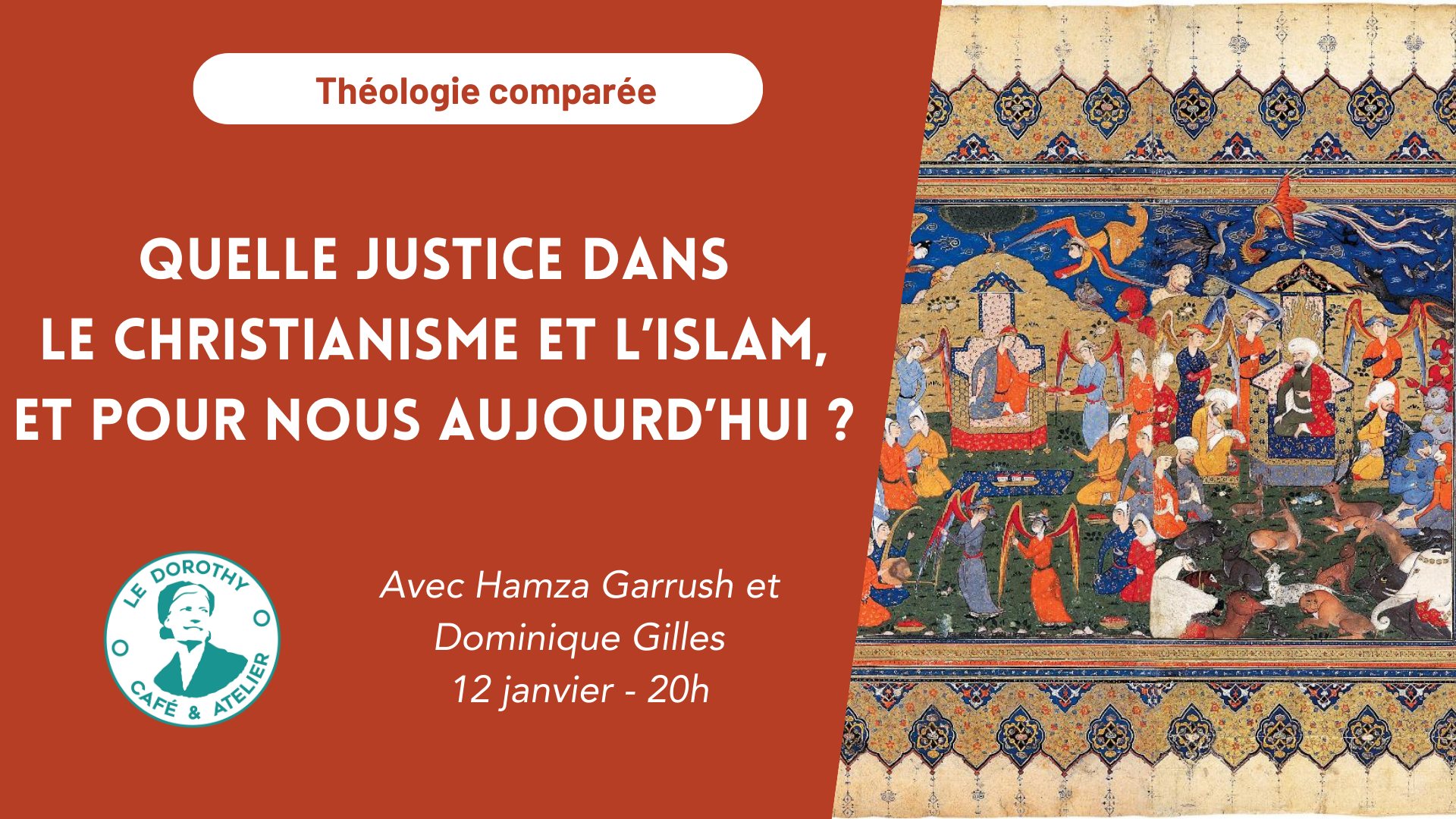Témoignages de la vie au Dorothy
Le témoignage de Franko
Je viens au Dorothy le jeudi. Je participe à l’entretien du jardin. Nous avons quelques projets d’introduction de végétaux. Nous pensons aussi à une vigne vierge sur le mur de droite, qui constituerait un micro-biotope pour des pollinisateurs. Nous créons via un groupe facebook un herbier détaillé de tous les végétaux déjà présents, et de ceux qui sont en projet de mise en place. Cet herbier sera aussi progressivement à disposition, sous forme d’un classeur dans la bibliothèque, avec des planches botaniques. A terme, nous constituerons un groupe participatif d’étude botanique.
Je participe aussi au dimanche du Dorothy.
J’ai pu, par la fréquentation de notre café-atelier, créer des liens sociaux et d’amitié, qui comptent beaucoup pour moi.
Franko
Le témoignage de Cécile
J’ai découvert le Dorothy en prêtant main forte à l’hébergement d’urgence, en partenariat avec l’association Utopia56. Il s’agissait d’accueillir des familles et femmes nécessiteuses en leur proposant un logement pour la nuit. Le Dorothy a depuis arrêté cette activité. J’ai continué à pouvoir me rendre utile en organisant plusieurs réveillons pour nos habitués et, actuellement, en tenant régulièrement le café solidaire. Quasiment tous les après-midis, Le Dorothy ouvre ses portes aux habitants du quartier, personnes isolées, en situation précaire. Dans ce joyeux mélange, des jeux sont organisés, des discussions aussi, autour d’un café. Le Dorothy est donc un espace où l’on peut se mettre au service de l’autre, donner de la chaleur humaine à des personnes isolées, recevoir d’eux, par des discussions, échanges et partage.
Autour du Dorothy gravite toute une communauté d’habitués que je prends plaisir à retrouver, aux différents événements du Dorothy et notamment au dimanche du Dorothy, repas partagé un dimanche par mois, moment convivial et festif.
L’an dernier, j’ai pu contribuer à organiser et animer une table ronde sur la fin de vie avec Isabelle de Gaulmyn et Philippe Portier, autour du livre de La Croix « Choisir sa mort ». Un beau moment d’approfondissement du sujet de la fin de vie, de réflexion.
Des ateliers manuels, les mardis soirs, rythment également la vie du Dorothy, attirent des voisins, familles, amis. De beaux moments d’apprentissage et de rire !
Cécile
Le témoignage de Marguerite
La première fois que je suis venue au Dorothy, pour une conférence, je ne connaissais personne. Mais un bénévole était venu me voir, m’avait dit bonjour, et m’avait présentée à d’autres. J’avais alors commencé une conversation avec mes voisins de table, que je ne connaissais pas. Tout semblait facile : je me sentais accueillie, et rapidement, ceux qui étaient à côté de moi n’étaient plus des inconnus.
Je crois que c’est pour cela que depuis trois ans, je suis si engagée au Dorothy. J’ai le sentiment que dans ce lieu, perdu dans cette grande ville anonyme, chacun est connu, bienvenu et presque attendu. Alors, tout devient possible : je peux y proposer avec d’autres, des idées folles, partir faire du maraîchage avec des habitués, proposer un cycle de ciné sur les chrétiens révolutionnaires d’Amérique latine, ou trouver un logement à quelqu’un qui n’en a pas.
C’est aussi une petite bulle dans nos vies surchargées où tout à coup, quand on passe la porte, le temps s’arrête. Je me laisse embarquer dans des conversations avec des gens que je n’aurais jamais croisés, je me retrouve une serpillère dans les mains en train de laver le sol, tout en réfléchissant à la manière de résoudre les inégalités. Je crois que le Dorothy est un lieu où j’ai appris à me donner dans les petites choses pour quelque chose de plus grand, et peut-être pour essayer, à une toute petite échelle, de construire un monde plus juste et fraternel.
Marguerite